LUMINARIUM
mosaïque de vingt-sept fragments de musiques du Monde
concerto pour clarinette et orchestre
(2002)
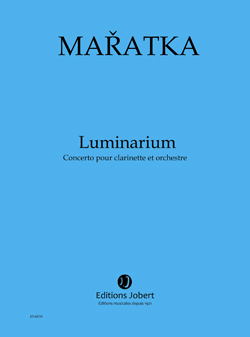
Mouvements :
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
Durée : 30'
Commande de Henry Selmer-Paris.
Grand Prix et Prix du Public du Concours Alexandre Tansman en 2006.
Effectif : clarinette en Si bémol solo, 1 Grande flûte (muta piccolo), 1 Hautbois, 1 Clarinette si bémol (muta flûte à coulisse), 1 Basson, 1 Cor en Fa, 1 Percussions, Cordes (minimum 4-4-4-3-2)
Percussions en détail: Grosse caisse, Bongo, 2 Congas (aigu, médium), Caisse claire, Tom-tom (médium), Tam-tam (petit), High-hat, Cloche à tube Si bémol aigu (joué avec un petit marteau métallique), Grelots, Wood-block, Crécelle, Maracas, Wood-chimes
Création : Michel Lethiec et l’Orchestre Poitou-Charentes au Festival de Sully-sur-Loire en juin 2002
Éditeur : Les Éditions Henry Lemoine affichent des informations sur cette œuvre sur
http://www.henry-lemoine.com/fr/catalogue/compositeur/maratka-krystof
Pour plus d'information contacter:
Éditions Henry Lemoine - Paris
Mme Laurence Fauvet - Location et achat des partitions
orchestre@editions-lemoine.fr / +33 (0)1 56 68 86 75
Éditions Jobert
Éditions Henry Lemoine - Paris
Mr. Benoît Walther - Service promotion, diffusion
bwalther@editions-lemoine.fr / +33(0)1 56 68 86 74
Éditions Jobert
Enregistrement :
Extrait de partition :
Notes sur l’oeuvre :
Luminarium, concerto pour clarinette et orchestre, se présente comme un kaléidoscope d’harmonies et de sons venus du monde entier, une sorte de brève anthologie qui trouve son inspiration dans des expressions musicales de diverses régions de la Terre.
Plutôt que le développement d’un seul récit, le concerto paraît à l’image d’un documentaire qui propose d’observer une fascinante diversité de multiples langages musicaux. Neuf mouvements portent l’architecture de la pièce, divisés chacun en trois parties, soit vingt sept fragments qui s’inspirent de vingt sept pays différents.
Cette synthèse crée un univers sonore mouvant, véhiculé par la clarinette, qui, lors de son parcours, « illumine » diverses faces du globe comme l’évoque le titre de l’œuvre.
I Bua’ (Indonésie), rite du soleil levant
Kouchnaï (Ouzbékistan), improvisation
Guègues (Albanie), chant funèbre
II Sitot me soi (France), chant troubadour
Madrosh (Syrie), chant liturgique
Nô (Japon), interjections du thêatre Nô
III Beranca (Macédoine), danse
Ngapa (Australie), cérémonie du Rêve de la pluie
Nira (Maroc), improvisation
IV Hat chèo (Viêtnam), chant du sorcier du thêatre hat chèo
Maôme (Îles Salomon), cycle funèbre
Chinos (Chili), chant des alféreces
V Rdo-rje’jigs-byed dbang (Tibet), psalmodie boudhique
Doudka (Biélorussie), improvisation
Pane (Bohème), chant liturgique
VI Mané igini kamu (Papouasie-Nouvelle Guinée), chant pour laver un enfant
Nipaquhiit (Arctique), jeux vocaux
Âvâz (Iran), chant persan
VII Skutchna (Yiddish), danse juive
Czardas (Moldavie), danse
Sousta (Grèce), danse
VIII Pasi but but (Taïwan), chant de prière pour une récolte abondante du millet
Ghau kilori (Mélanésie), orgue éolien pour l’immersion d’un cadavre dans la mer
Leiskis leiskis saulela (Lituanie) , chanson des moissons
IX Tioudiouk (Turkménistan), improvisation
Sampatye (Sénégal), chant des jeunes filles initiées
Xwââxâ (Nouvelle Calédonie), discours rituel

